Rechercher : boton
Alain Boton : Opération Duchamp (entretien avec Alain Santacreu)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 24 janvier 2019 | Lien permanent | Commentaires (2)

Les Mirages de l’Art contemporain
suivi de Brève histoire de l’Art financier
La Table Ronde, 2018, 320 p.
___________________________________________________
L'AC ou l'affliction de l'indistinction
Alain Santacreu
mardi, 26 juin 2018 | Lien permanent
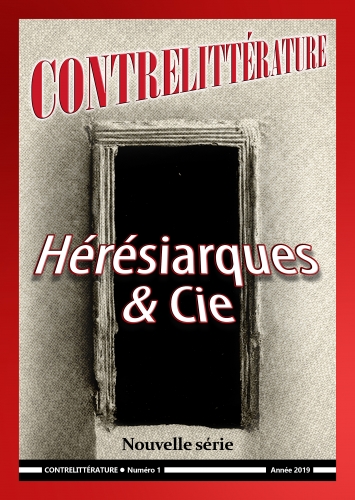
SOMMAIRE
|
|
Le Contr’Un littéraire.................................................................Alain Santacreu Dualité radicale de cet univers.......................................................José Dupré Poètes sur la talvera.....................................................................N. Raffi/M. Marmin/S. Fabre-Coursac Cioran, dans les cendres du dernier cathare...................................Roland Poupin Albert Vidal : regarder la vie avec les yeux de la mort..................Maryse Badiou Lupasco : Interférences électives.....................................................Basarab Nicolescu Jean Parvulesco et le cinéma .........................................................Michel Marmin (entretien) La ligne du devenir dans le cercle de l’être.....................................Jean-Michel Wizenne George Catlin, medicine painter...................................................Paul Sunderland Duchamp : un éveillé au centre de la modernité !...........................Alain Boton Chemins d’hérésie (portfolio photographique).................................Richard Pigelet
La revue Contrelittérature est disponible
Par Paypal (en haut, colonne de droite).
en s'adressant à l'éditeur : (chèques et commandes libraires) ContrelittératureL'Ancien Presbytère28170 Saint AngeChèque à l'ordre de "Contrelittérature".
|
|
vendredi, 26 juillet 2019 | Lien permanent | Commentaires (2)
Un éveillé au centre de la modernité !
par Alain Boton
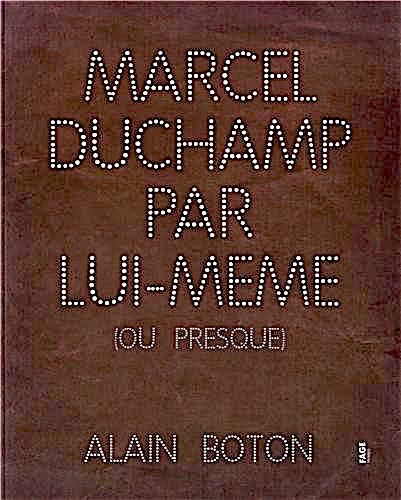
Éditions Farge, 2013, 264 p.
___________________
Le livre d’Alain Boton, Marcel Duchamp par lui-même (ou presque), paru il y a trois ans, a totalement bouleversé la critique duchampienne. L’auteur y décrypte le langage inventé par Duchamp pour formuler de façon codée sa théorie du processus créatif. Ce texte, écrit par Alain Boton pour Contrelittérature, pointe l'enjeu spirituel et anthropologique mis en oeuvre par le projet inouï de Marcel Duchamp.
Qu’aurait fait Jésus s’il était revenu au XX° siècle ? Sans doute aurait-il joué son propre rôle dans la comédie musicale Jésus-Christ superstar afin de donner un supplément d’âme au relookage de son message un rien empoussiéré ! Pourquoi pas ? La question n’étant pas sérieuse, la réponse n’a pas à l’être non plus. Par contre se demander quelle forme aurait pu prendre l’action d’un sage dans le XX° siècle occidental n’est pas si gratuit qu’il n’y paraît. En effet il n’est pas vain de réfléchir à ce qu’aurait pu nous apporter durant le siècle de la démesure un grand spirituel ayant acquis cette extraordinaire lucidité sur la condition humaine qui caractérise ceux qui ont vécu une ou, le plus souvent, plusieurs expériences extatiques profondes. Bergson dans son essai Les deux sources de la morale et de la religion fait une grande place dans la genèse et dans l’évolution de nos conceptions du monde aux mystiques et aux saints du passé. Il est clair pour lui qu’ils nous ont instruits. Alors au XX° siècle, qu’aurait eu à transmettre un « éveillé »? Où, dans quel milieu, aurait-il tenté d’agir ? Comment s’y serait-il pris ? Discours ? Prêche religieuse ? Exemplarité ? Aurait-il été seulement possible d’entendre la voix d’une telle personne dans la cacophonie des batailles idéologiques ? Pense-t-on que les modernes l’auraient aisément écouté ? Qu’aurait-il fait pour dissoudre notre carapace de certitudes ?
Aurait-il prononcé des centaines de conférences de par le monde, écrit des milliers de pages afin de nous faire comprendre que le langage n’est d’aucune utilité pour « voir » la réalité, comme l’a fait Jiddu Krishnamurti en assumant clairement ce paradoxe ? Pas sûr. Il n’est besoin d’aucun discernement particulier pour se rendre compte que les livres de Krishnamurti sont maintenant devenus des produits culturels difficilement différenciables d’autres produits pourtant ouvertement conçus afin de flatter le lecteur dans sa recherche d’un mieux-vivre confortable et ainsi rapporter à son auteur gloire et richesse. Inutile de citer des noms, c’est par dizaine que les gurus, pas obligatoirement californiens, se disputent cette niche économiquement très rentable.
Aurait-il eu l’intelligence et l’humilité du sage taoïste qui sait que l’on n’instruit le peuple qu’en s’y fondant ? Il aurait alors pu écrire des chansons populaires qui s’infiltrent et agissent dans les cœurs de quelques générations ? Pourquoi pas, c’est ce qu’a fait Georges Brassens et cela a plutôt bien fonctionné. Qui n’a pas fait siennes les leçons de vie simples et essentielles de L’auvergnat, de La mauvaise réputation ou de Mourir pour des idées, pour ne citer que ces trois-là ?
Aurait-il simplement veillé l’humanité souffrante, persuadé que rien ne peut changer son sort ? Comme l’a fait Armand Robin qui passait ses nuits à écouter dans toutes les langues les radios soviétiques faire leur travail d’anéantissement de l’esprit jusque dans ses moindres traces. Bataillant tout de même, comme un shaman dans la nuit noire, seul contre l’hydre monstrueuse, afin de sauver de l’oubli quelques poètes ici et là.
Ce serait-il mêlé à l’histoire comme la mystique chrétienne Simone Weil partant rejoindre les brigades internationales durant la guerre d’Espagne ou bien au contraire aurait-il mis toutes ses forces, comme mère Teresa ou les french doctors, à soulager les gens, tant que faire se peut, des violences que déclenchent les batailles identitaires toujours renouvelées depuis la nuit des temps ?
Aurait-il pensé que, la catastrophe écologique étant imminente, l’urgence serait de donner aux divers mouvements ayant pris conscience de la gravité de la situation une intelligence de ce qu’est la modernité qui viendrait remplacer les vieilles grilles de lecture religieuses obsolètes comme le millénarisme marxiste ou le christianisme soft d’un Ivan Illitch ou d’un Jacques Ellul ?
Aurait-il misé sur l’université, garante des savoirs, pour nous enseigner quelques principes de base ? Rien n’est moins sûr, tant elle prime une virtuosité conceptuelle et rhétorique antinomique à toute sagesse. À moins d’être sûr de vivre deux fois cent-vingt ans, on voit mal un éveillé se lancer dans la carrière universitaire pour former des élèves qui formeront des élèves qui formeront des élèves qui finiront par se noyer dans un flot de palabres et d’invectives feutrées.
Bien entendu, si je pose cette question et, on l’aura compris, doute de l’efficacité de toutes réponses imaginables, celles ci-dessus mais bien d’autres encore, c’est qu’il me semble clair que si cette personne possède véritablement une lucidité inconcevable pour le commun des mortels, elle aurait agi bien évidemment d’une façon qui nous paraîtrait encore aujourd’hui inconcevable. Et tel a bien été le cas. Marcel Duchamp a bien agi ainsi.
Marcel Duchamp, en effet !
Celui-là même qu’on prend aujourd’hui pour un artiste dada, provocateur plus ou moins libertaire. Celui qu’on définit soit comme un manipulateur cynique, soit comme un génie créatif qu’il est bon de savoir apprécier, selon la position qu’on a adoptée par rapport à l’art contemporain. En quoi ce type élégant, charmeur, fumant le cigare et raffolant des pieds de porc vinaigrette et des jeux de mots stupides peut-il être un éveillé ?
Il faudrait un renversement vraiment radical pour en faire un bouddha du XX° siècle.
En effet.
Mais il existe depuis toujours un type de renversement de perspective simple et connu de tous, il se nomme l’ironie. Plutôt que de dire le vrai que nous ne supporterions pas d’entendre, l’ironiste va prêcher le faux à outrance jusqu’à ce qu’il nous apparaisse explicitement comme faux et qu’ainsi nous puissions a contrario percevoir de nous-mêmes ce que pourrait être le vrai. Ainsi quand ceux qui ont abondé dans le sens du discours que l’ironiste a exprimé, mais qu’il ne pense pas, s’aperçoivent que ses propos mènent à des absurdités caricaturales, ils comprennent qu’ils se sont fait piéger. Dès lors, au dévoilement des intentions véritables de l’ironiste, tout se renverse. Les premiers deviennent les derniers et il y a des grincements de dents. Le sage ironiste, plutôt que de tenter de nous enseigner ce qu’est la sagesse, comme ont tenté de le faire les grands spirituels depuis des siècles avec le peu de succès que l’on sait, enseigne ce qu’elle n’est pas et ce qui empêche définitivement d’y accéder, la vanité. L’ironie est la méthode que déjà Socrate employait dans ses dialogues, c’est celle qu’utilisa Duchamp pour nous montrer sur quelles motivations repose l’art moderne et contemporain, afin de nous faire comprendre enfin ce qu’est le jugement de goût sur lequel les philosophes se cassent les dents depuis Baumgarten.
Mais entrons immédiatement dans l’Histoire, que vous puissiez saisir que l’œuvre de Duchamp a été à la fois tangible et efficace et dans le même temps restera longuement inacceptable tant elle vexera absolument tout le monde. En effet, peut-on croire qu’un homme qui aurait cette lucidité exceptionnelle sur les motivations de l’homo sapiens endimanché qu’est le moderne aurait à nous faire parvenir un message flatteur sur nous-mêmes ? Il n’y a qu’à regarder l’état de violence institutionnel du monde pour savoir que son propos ne peut être qu’extrêmement déplaisant à entendre. Alors laissez-moi vous raconter de manière très résumée ce à quoi Duchamp a consacré sa vie.
En 1913, il découvre ou croit découvrir dans l’art moderne tel qu’il s’est développé depuis le milieu du 19° siècle une constante. Une constante qui lui semble si déterminante pour ne pas dire si déterministe qu’il la nommera la loi de la pesanteur. Cette loi peut être résumée ainsi : Pour qu’un objet d’artiste devienne un chef-d’œuvre de l’art, il faut qu’il soit d’abord refusé par une majorité, en général scandalisée, de telle sorte qu’une minorité agissante trouve un gain, en termes d’amour-propre, à se différentier d’elle en réhabilitant et l’artiste et son objet.
Cette pesanteur a le même sens pour Duchamp que pour la mystique chrétienne Simone Weil, c’est notre vanité, notre indispensable amour-propre. Alors, plutôt que d’instruire ses contemporains de sa découverte - Il sait que personne ne voudra l’entendre - il décide de mettre cette loi à l’épreuve de l’expérience au plus près de la méthode scientifique expérimentale. Il se dit que si cette loi est bien aussi déterministe qu’il le pense, n’importe quel objet, même le plus inadéquat a priori comme un urinoir, peut devenir un chef-d’œuvre de l’art. S’il débute sa carrière par un refus ostensible archivé dans l’histoire de l’art, obligatoirement, à un moment ou à un autre il y aura une minorité pour réhabiliter cet objet d’artiste.
Et pour bien montrer qu’il se lance avec Fontaine dans une expérience quasi scientifique et non dans une simple provocation, il décide d’élaborer un protocole d’expérience, qui aura la forme standard de tout protocole : étant donnés ceci et cela, si je fais ci et ça, il devrait se passer ça. Mais pour autant son protocole doit rester secret pour ne pas fausser l’expérience, pour ne pas influer sur le comportement des amateurs d’art qu’il est en train de transformer en cobayes. En même temps son protocole se doit d’être lisible à la fin de l’expérience, c’est-à-dire une fois l’urinoir devenu chef-d’œuvre de l’art. Pour concilier ces deux paramètres, cacher à ses contemporains et dévoiler aux générations futures, il créera La mariée mis à nu par ses célibataires, même qu’on nomme aussi le Grand Verre. Ce tableau, associé aux notes qui le décrivent, plus d’une centaine de pages, est le schéma fonctionnel du monde de l’art, il décrit assez précisément par quels mécanismes psychologiques et sociologiques un vulgaire chiotte va accéder au statut de chef-d’œuvre du XX° siècle. Et, pour rester imperceptible à ses contemporains cette description, bien que très précise, est cryptée, ainsi que l’ensemble de tous les objets, notes et interventions de Duchamp dans le monde de l’art qui forment une sorte d’immense rébus se rapportant à sa mystification. On peut dire que finalement il n’y a qu’une seule œuvre de Marcel Duchamp, et elle n’est pas d’art puisque c’est cette expérience sociologique grandeur nature. Et puisque cette expérience est ironique, ceux qui se croyaient observateurs privilégiés en position de surplomb par rapport à la modernité et son art, les critiques savants et les amateurs d’art qui ont suivi Duchamp et ont fait d’un urinoir un chef-d’œuvre, se retrouvent finalement au centre de l’amphithéâtre, observés comme des petits rats de laboratoire. Ils pensaient faire montre d’une intelligence exemplaire et enviable, Duchamp nous fait toucher du doigt, à travers eux, le pouvoir hallucinogène de la vanité.
Je vois, moi, que tout le travail tout le succès d’une œuvre, c’est jalousie des uns envers les autres : cela aussi est vanité et poursuite de vent (L’Ecclésiaste).
Il suffit pour saisir la dimension spirituelle du personnage sans même avoir pris connaissance de son propre témoignage – ce qui serait bien trop long ici – de noter premièrement que Duchamp est un môme de 26 ans n’ayant pas lu trente livres quand il découvre le processus, encore subtil à l’époque, refusé par les uns/réhabilité par les autres, qui est le moteur sociologique de l’art moderne, alors qu’aucun des plus grands intellectuels du siècle n’a été capable de le déceler, alors même qu’il devenait de plus en plus explicite au fil du temps, jusqu’à sauter aux yeux depuis que la provocation systématique du scandale est enseignée ouvertement aux Beaux-arts; et, deuxièmement, que cet homme va se tenir à un secret absolu durant toute sa vie, se laissant encenser par ses propres amis et tous ceux qui l’entourent pour une œuvre d’art qui n’existe pas, pour un talent qu’il méprise, pour une pensée qui n’est pas la sienne, sans jamais opposer le moindre démenti.
Mais, me direz-vous, ce processus refus/réhabilitation ne concerne que les happy few qui aujourd’hui encore se pâment devant le génie d’un Jeff Koon ou d’un Maurizio Cattelan, on ne voit pas en quoi le comportement de cette minorité que Duchamp a épinglée serait propre à nous éclairer sur le comportement de l’Homme dans sa dimension universelle. Réagir ainsi c’est se focaliser sur la paille dans l’œil du voisin.
Duchamp utilise l'expression de renvoi miroirique pour qualifier la position des regardeurs face à l’objet d’artiste, qu’il soit un urinoir ou un tableau de Monet, afin d’exprimer le fait que ces regardeurs projettent d'abord sur l’œuvre des qualités qui leur semblent valorisantes (liberté, singularité, innovation…) pour propulser grâce à leurs discours l’objet d’artiste vers la postérité et qu'ainsi, à terme, une fois l’objet consacré en chef-d’œuvre de l’art par toute une époque grâce à ce discours performatif, l’œuvre leur renvoie une image d’eux-mêmes où toutes ces valeurs qu’ils y avaient eux-mêmes déposées auparavant sont maintenant reconnues et célébrées. Le fait qu’un urinoir, objet explicitement vide de toutes qualités esthétiques communément admises, devienne de manière prévisible une œuvre d’art d’importance prouve que l’objet créé par l’artiste ne sert que de support à ce jeu de projection/réflexion par lequel les regardeurs se « distinguent » entre eux et se façonnent une identité singulière. Ainsi toutes les œuvres de l’art forment un ensemble qui fonctionne comme un immense kaléidoscope de miroirs que le regardeur manipule à sa guise afin de customiser l’image qu’il a de lui-même. Duchamp montre ainsi le rôle du jugement de goût et de l’expérience esthétique : se sentir exister, prendre plaisir à se dessiner, à se pomponner l’identité. Attention, Duchamp est un grand spirituel et non pas un curé ou un idéologue qui juge de ce qui est à l’aune de ce qui devrait être, ne voyant dans la réalité que ce qui lui fait défaut pour coller à son idéal religieusement préétabli. Il nous montre que tous les jugements de goût fonctionnent en renvoi miroirique, quel que soit le regardeur et quel que soit l’objet regardé. Exit l’opposition factice entre authenticité et snobisme. Nous avons affaire à une donnée anthropologique. Vexante, difficile voire impossible à assimiler mais prouvée par l’expérience. Même si cette expérience probante est très localisée, puisqu’elle met en cause le moderne occidental pour une attitude que beaucoup qualifient jusqu’à présent de snobisme pour accentuer son aspect outrancier et ainsi s’en dédouaner, elle démontre la fonction identitaire agonistique et mimétique du jugement de goût qui vaut pour tous les jugements de goût, de celui qu’on décèle à l’origine de la progression de l’industrie lithique des hominiens vers une perfection géométrique belle et inutile, jusqu’à celui qu’on porte aujourd’hui sur le design d’une voiture, d’un meuble ou d’un vêtement.
En effet, il faut élargir le champ d’application de la découverte de Duchamp et comprendre que cet effet de miroir magique qui définit le jugement de goût fonctionne avec tous les objets culturels. Cela va des tableaux de Courbet et Manet jusqu’à mon jean 501 et mon canapé Ikea. Ce processus onanique comme dit Duchamp est la clé de compréhension de ce que Debord nommait la société du spectacle et qu’il vaut mieux nommer modernité tout simplement. Marx pensait trouver le secret du mana de la marchandise dans son processus de production, Duchamp montre par son expérience sociologique que c’est dans cet effet de miroir magique, humainement inévitable et authentiquement jouissif, qu’il se loge. Ce qui rend compte de l’esthétisation du monde par le capitalisme artiste, comme dit Gilles Lipovetsky, dont la logique
mardi, 29 novembre 2016 | Lien permanent

L’hypothèse Grabar
Alain Santacreu
__________________
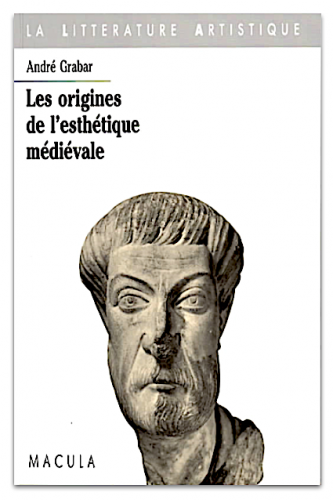 Dans son article, André Grabar s’inspire de l’interprétation d’Émile Bréhier8 pour expliquer cette notion plotinienne de « vision intellectuelle ».
Dans son article, André Grabar s’inspire de l’interprétation d’Émile Bréhier8 pour expliquer cette notion plotinienne de « vision intellectuelle ».mercredi, 18 juillet 2018 | Lien permanent
Page : 1