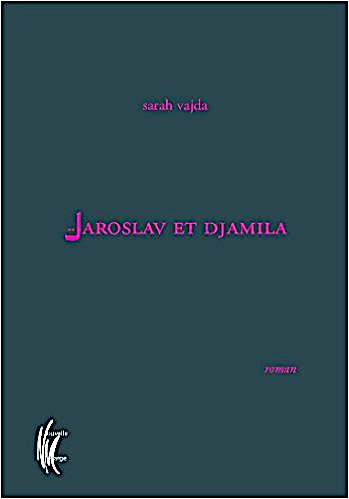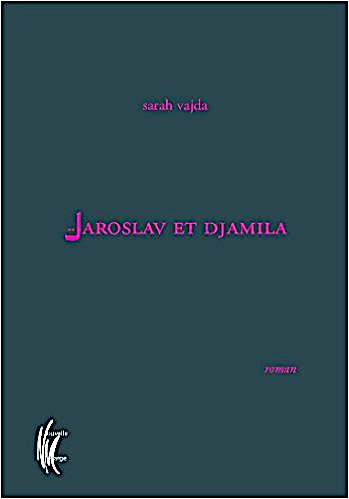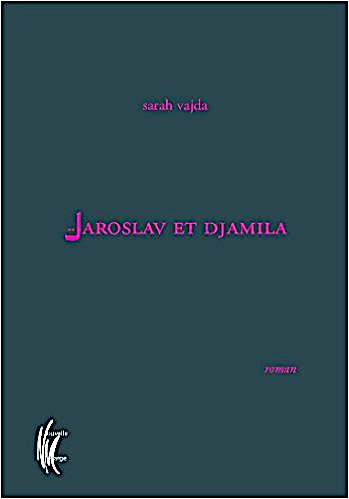
Sarah Vajda
Jaroslav et Djamila
Éditions Nouvelle Marge
185 pages, 17 €
Dans toutes les librairies et directement chez l'éditeur
LE ROMAN ET SON DOUBLE
par Alain Santacreu
Il faut lire Jaroslav et Djamila de Sarah Vadja[1] comme on écoute un oratorio, jusqu’à l’apothéose finale d’une parole devenue femme. Le lecteur de ce roman s’en tiendra à cette profession de foi émise par le narrateur : « Je ne fais pas de littérature, je tente d’y résider » (45) ; car il s’agit de construire sa demeure en lisant.
L’action romanesque se laisse facilement résumer : Djamila, transportée aux urgences de l’hôpital Beaujon de Clichy-sous-bois-et-sur-Seine, est prise en charge par Nico et le narrateur. Le premier, jeune idéaliste révolutionnaire, fait un stage dans cet établissement ; le second est le docteur S., le narrateur du roman, chef du service des brûlés. Ce dernier personnage sans grande envergure romanesque —sans nom, veuf — est l’instance narratrice qui va rapporter les récits alternés de Djamila et de Jaroslav.
Dix ans auparavant, dans une cité du « Neuf-Trois », les deux jeunes gens ont connu la passion lors d’une brève rencontre ; mais, Djamila, mariée à Mehdi et mère de deux enfants, préféra sacrifier leur amour et Jaroslav, l’immigré ukrainien, s’enfuit au Canada.
Lorsque débute le roman, la rupture a précipité Djamila dans la folie et amené Jaroslav à refouler tout souvenir, ayant oublié l’existence même de Djamila. Il est maintenant marié à Svetlana et père de trois garçons. Un accident cardiaque, survenu lors de la pendaison de la crémaillière de la maison qu’il a construite, lui rend la mémoire. Sur son lit d’hôpital, le souvenir de sa merveilleuse rencontre resurgit, phénomène d’anamnèse similaire et concomitant à celui que vit, à des milliers de kilomètres, Djamila retrouvant, grâce à l’écoute amicale de Nico et du narrateur, son âme d’adolescente. Le fil du récit amoureux est ainsi renoué, revivifiant l’état d’être romanesque des deux amants. Victoire de l’anamnèse : voie inversée de Djamila à Mila et redécouverte par Jaroslav de l’être aimée.
Djamila parle. Petite fille de harki du côté maternel, elle a vécu à Annecy jusqu’à son adolescence. Sa vie était celle de toutes les jeunes filles françaises : « Fille des années 1970, Mila, comme on se plaisait à la nommer alors, était une petite fille de France à qui son origine musulmane n’attachait ni clochette de lépreuse ni couronne prophétique » (75).
Le destin de Djamila bascule lorsque sa mère, Chérifa, meurt en couches. Son père, Kamel, immigré marocain, se transforme alors en rigoriste religieux et l’oblige à se conformer à la tradition musulmane. Il l’amène à Casablanca et la confie à son oncle Hafez. Elle est « rééduquée ». Sa personnalité est niée : « De l’ado que fut Mila, rien n’est demeuré en Djamila » (112). Mariée à Mehdi, elle retourne en France, dans le Neuf-Trois, cité des Poètes, le quartier où, quelques années plus tard, elle rencontrera Jaroslav.
Tout au long du roman, le narrateur attribue de nombreuses caractéristiques littéraires à Djamila. Elle est la « belle Ophélie d’Orient », la « fille d’Aphrodite céleste », l’« éternelle Juliette », la Muse de La Nuit de mai d’Alfred de Musset (« Poète, prends ton luth... ») ou encore Sheherazade et la Princesse de Clèves ; mais, parmi toutes ces références, se détache celle de Gradiva, le personnage de la nouvelle de Wilhem Jensen rendue célèbre par l’analyse qu’en a faite Sigmung Freud (Le Délire et les Rêves dans la « Gradiva » de W. Jensen). Un jeune archéologue tombe amoureux de l’image d’une jeune romaine très belle, à la démarche ailée, qu’il découvre gravée dans le marbre d’un bas-relief antique : il la nomme Gradiva, « Celle qui marche », en latin. Dans le délire du rêve post-opératoire de Jaroslav, Djamila apparaît sous les traits de Gradiva : « Jaroslav ne se souvenait pas d’avoir jamais vu personne marcher comme marchait Djamila, sans poser, semblait-il, à moins que ce fût un effet trompeur du souvenir, le pied sur la terre, sans y laisser aucune empreinte [..] Il se la représentait, Gradiva, toujours en marche ou du moins en mouvement, le bras levé, la main tendue, le corps, le pied, en suspens. Il voulait la retrouver, être certain qu’il n’avait pas rêvé et ne l’avait pas inventée » (178)
Djamila en Gradiva provoque non seulement le délire passionnel de Jaroslav mais aussi le désir d’écrire, ainsi que l’exprime Nico : « Nous écrirons votre histoire, vous, la contant et moi, vous tenant un peu la main, attentif à ce que vous ne remisiez aucune splendeur, aucun détail flatteur que votre modestie, sans mon aide, prendrait bien soin d’omettre, et ce livre deviendra le livre de chevet de tous les professeurs de français et d’instruction civique du pays, la Bible de toutes les jeunes filles "issues de la diversité" » (133).
Cette fonction sociale de l’écriture est une dimension importante du roman. Le personnage de Nico est l’embrayeur qui permet « l’entrée dans le roman » du narrateur : « Sans Nico, je n’en aurais rien su, et Djamila serait demeurée une ombre passée dans mon service » (37). Le narrateur ne cesse d’ailleurs de reconnaître sa dette : « Avant que Djamila et Nico n’aient paru dans ma vie, je n’étais qu’une loque humaine. Pas un héros de roman » (32). Victoire du roman, venu à l’existence par la grâce juvénile de Nico dont le nom, en grec, évoque la victoire, Nikê. Le narrateur, entraîné par l’enthousiasme du jeune homme, devient lui aussi amoureux de Djamila. Son cœur bat au rythme de sa narration qui est le récit rapporté de Djamila : « Depuis que Djamila avait fait son entrée dans mon existence, je me prenais à l’aimer, somptueuse, réglée par la seule attente de ses récits [...] je rentrai au plus vite, impatient malgré moi de savoir la suite du récit trop longtemps différé » (129-130).
Djamila a renoncé à son éclatante passion pour Jarovslav car elle était incapable d’outrepasser la volonté du père. Ce n’est que par le retour à la mère qu’elle pourra se libérer : « Chérifa ! Son départ avait anéanti Djamila, seul son retour saurait la reconstruire, la ramener d’entre les limbes » (121) Le personnage de Chérifa est sans doute le personnage le plus lumineux du roman, elle est la présence intérieure qui oriente le retour de Djamila à la vie.
Il est très signifiant que l’auteur ait fait renaître la fine amor dans un quartier populaire de la Seine-Saint-Denis. La jet-set d'aujourd'hui, à la sexualité obsessionnelle, correspond à la classe des nobles désoeuvrés de la courtoisie médiévale où naquit la littérature et le roman. La fine amor des troubadours était d’une tout autre nature que cet amour courtois de la société aristocratique et oisive qui n’était qu’un jeu social. Jarovslav et Djamila, dont les êtres connaissent une polarisation absolue, retrouvent intuitivement cette fine amor provençale, libre et a-sociale, imprégnée des mystiques orientales, juive et musulmane, et notamment la kabbale : « D’instinct il [Jaroslav] devinait la peau pleinement accordée à la sienne, certain à l’avance d’atteindre, la touchant, l’extase promise par les poètes et les chanteurs de bal. Il savait, sans l’avoir jamais appris la proximité sémantique du mot hébraïque or qui signifie lumière avec ‘or qui signifie la peau, et la méthode imaginée par les juifs pour faire de l’homme un corps de gloire recouvert provisoirement d’un épicarpe, une gangue, une enveloppe » (98). La poésie de la fine amor est le double de la prose du roman courtois. Elle contient le secret de la parole du corps glorieux. Jaroslav est pour Djamila, cette parole retrouvée — la dernière des trois syllabes de ce nom qu’elle répète comme une litanie, Jaroslav, renvoie au mot slavo qui, en slavon, signifie parole.
Gilles Deleuze, dans Critique et clinique, rappelle cette évidence : « Ce ne sont pas les deux premières personnes qui servent de condition à l’énonciation littéraire ; la littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire Je. » Tel est l’antagonisme, inscrit dans le marbre de Gradiva : elle est double, immobile et en mouvement, pétrifiée et vivante, aliénée et libre, fictive et charnelle. Elle indique, rend perceptible et, dans le même temps, se dérobe, emportant avec elle l’énigme qu’on lui prête. Ce dynamisme structurel réapparaît en Djamila : « Voici venir la fiancée. Quand bien même elle aurait mis au monde une dizaine de marmots, sans difficulté, imaginait-il [Jaroslav], avec cette grâce sans pareille qu’elle mettait à toute chose, elle ne cesserait de se tenir pudique et impudique, timide et hardie, toute de lumière et d’ombre, de brusquerie et de délicatesse » (178).
Retrouver Jaroslav, c’est donc pour Djamila retrouver la parole mais elle ne peut le faire qu’en retrouvant la capacité de dire « Je ». (« Je » renvoie phonétiquement à « Dja », la première syllabe du nom de l’héroïne).
À quoi tient le charme de Djamila ? À ce savoir d’amour, cette souffrance qu’induit la folle passion, ouverture vers la connaissance de ce double poétique du roman qui ouvre la voie du corps glorieux.
Le double du roman est l’objet de la folie de Djamila — et aussi de l’amnésie de Jaroslav. Objet du désir, symbolisé par le foulard, brodé par sa mère, « de cotonnade blanche tramé de fils d’or, exagéré de larges fleurs roses et noires » (18), que Jaroslav offre à Djamila lors de leur unique soirée à Paris. Désir qui devait demeuré désir, car la fine amor ne peut prendre fin dans la durée : « J’ai jamais fait l’amour. Enfin, jamais comme dans les livres. Peut-être pour ça que j’ai fait ma princesse de Clèves, quand Jaroslav a paru » (163).
L’idéologie qui impose à l’homme la croyance en la stricte réalité biologique de la sexualité triomphe aussi bien dans la société religieuse « traditionnelle » que dans notre société du spectacle. Comme le hurlera Djamila à ses deux interlocuteurs : « Casa ou le Neuf-Trois, kif kif , mes frères... » (162). Aussi, n’est-il pas anodin que la révolte décisive de Djamila commence par la destruction du poste de télévision : « Entre finales de foot, bêtisiers, jeux, et j’en passe, il avait bien servi l’écran noir néant avant que je ne le brise menu. Accident domestique. Shooté dans la téloche. Enfin tapé dessus à coup de casseroles. » (169). La télévision joue le rôle que la littérature — coupée de son double — a joué durant des siècles : « Des ectoplasmes abusant de stéréotypes, fautes d’exister. Toute parole se fait cliché. Ici meurt tout récit. Seule la télévision, notre mère à tous, peut entrer : il n’y a plus rien à comprendre (153).
Qu’il faille passer par le roman pour s’extraire du roman est le grand paradoxe de l’écriture romanesque. La littérature n’est justifiée que par son double : « L’amoureuse rencontre, comme la guerre authentifie la littérature », dira le narrateur (102) ; car éros et thanatos forment la « materia prima » du roman.
Le double poétique se rattache au corps prosaïque du texte. Des citations de grands poètes français s’insérent dans le roman, comme des palimpsestes, avec une ironie toute romantique, produites par le contraste entre la réalité et l’idéal. Ainsi, Verlaine et Apollinaire : « Par-dessus les toits, à nouveau le ciel était si bleu, si calme, et sous le pont Todossiy Os’Matchna où coule le Dniepr, le temps passé et les amours revenaient » (16-17) ; ou, encore, cet extraordinaire pastiche baudelairien : « Au hammam, sous de vastes portiques, tout n’est que vergetures, cicatrices de césariennes, phlébites, varices et peaux d’orange à échanger contre belles peaux neuves et fraîches, à souiller et à abandonner. C’est là que j’ai vécu, yeux noircis de khôl, dans les voluptés sales, au milieu des ténèbres, des ombres, des laideurs et des esclaves folles toutes imprégnées d’odeur de savon noir, de rassoul et d’huile d’argan » (170).
La fin du roman permet au lecteur de comprendre que les chapitres consacrés au récit de Jaroslav n’ont pu être écrits qu’« après le roman » puisque la narration n’est pas omnisciente mais adopte un point de vue interne. Sarah Vadja nous propose une fin ouverte et distanciée : Djamila se jette à l’eau, Nico et Jaroslav se portent à son secours. Djamila sauvée des eaux ? Nico et Jaroslav rivaux ? Méli-mélo ? ou Djamila et Jaroslav retrouvés, éternelle victoire de l’amour sur la mort ? Dans l’eau amniotique de la Seine, Djamila entend la voix de Chérifa, victoire de la femme : « La voici sur l’ île aux Cygnes, face à la statue de la Liberté. C’est l’heure où toutes les femmes s’appellent Liberty Bell » (185).
Jaroslav et Djamila de Sarah Vajda, ultime roman de la fine amor dans une banlieue de France, signe l’acte de naissance des éditions Nouvelle Marge : on ne pouvait rêver plus belle mise en demeure !
___________
[1] Sarah Vajda, Jaroslav et Djamila, éditions Nouvelle Marge, 2016. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages du livre.