dimanche, 09 décembre 2007
La tragédie du Verbe
Détestable habitude en effet de gratifier d’une majuscule le mot que l’on prétend sauver de la trivialité en le renvoyant, ainsi magnifié, dans une sorte d’empyrée du langage aussi éloignée des platitudes de ce monde que l’étaient au regard de Platon les Idées. Mais Artaud n’est pas Mallarmé ! Jamais en effet le « pur glacier de l’Idéal » n’a laissé le poète qu’il fut transi, endeuillé, perpétuellement endetté vis-à-vis d’un Verbe dont se montreraient toujours indignes ses mots. Au plus fort des crises qui le laissaient pantelant et le faisaient douter de l’intégrité de son être, Artaud s’est-il jamais plaint de ne pas parvenir à trouver ses mots ? Le Verbe n’est certes pas n’importe quel vocable mais le souffle vital inhérent au Mot supposé par excellence créateur ; celui dont tout langage est censé tenir sa raison d’être et son pouvoir d’impressionner les âmes, marquées de son sceau : « Une impulsion psychique secrète qui est la Parole d’avant les mots », écrivait Artaud (2). Quand donc le mot Verbe, ou bien encore Parole apparaît ainsi valorisé sous sa plume, est-il pour autant revêtu de l’autorité d’un langage pour ainsi dire « principiel » puisque toujours antérieur à sa manifestation dans les mots ? un langage (Logos) que la tradition johannique nous a accoutumés à penser comme Verbe tant sa proximité avec Dieu (pros ton theon) en divinise la présence, en absolutise l’essence. Or rien ne paraissait à Artaud plus « obscène » que le lyrisme incontinent d’un Claudel, porte-parole autoproclamé d’un tel Verbe.
Et pourtant, Artaud aurait-il intenté au langage un si virulent procès s’il n’avait été assuré de l’existence d’un autre langage, plus organique d’ailleurs que verbal ? Ce « vrai langage » propre à l’essence même de la théâtralité, Artaud en a maintes fois évoqué l’efficacité, envoûtante et magique : « Langage spatial, langage de gestes, d’attitudes, d’expressions et de mimiques, langage de cris et d’onomatopées, langage sonore, où tous les éléments objectifs aboutiront à des signes soit visuels, soit sonores, mais qui auront autant d’importance intellectuelle et de signification sensible que le langage des mots. Les mots n’étant plus employés que dans les parties arrêtées et discursives de la vie, comme une clarté plus précise et objective apparaissant à la pointe d’une idée » (3). Ainsi ce langage concret, objectif mais dépourvu de toute grammaire susceptible d’en codifier l’usage, pourrait-il être ponctuellement accompagné du « langage de la parole » dont la mise en scène aurait exhumé, exhaussé les « mystérieuses possibilités ». Comment donc mettre en scène la juxtaposition ou l’alternance de ces deux langages sinon par une révolution intégrale de la théâtralité ?
Ni le Verbe, ni la Parole à quoi fait souvent référence Artaud – du moins jusqu’à son internement en 1937 – ne sont donc l’indice d’une plénitude perdue qu’il s’agirait de retrouver après s’en être par sa propre faute exilé. Le geste poétique et théâtral d’Artaud s’est en effet cherché très tôt une autre scène que celle, biblique, où un Dieu créateur et en cela démiurge imposa par son seul DIRE au monde de sortir du chaos. C’est ce FIAT créateur qu’il soupçonna d’avoir dissocié corps et esprit, condamnant de ce fait le monde à une irréalité mensongère ; et cela au détriment d’une plus obscure parturition dont le « secret » pourrait se révéler commun au théâtre et à la culture, et plus encore à cette réalité énigmatique qu’il nommera finalement et tout simplement « corps » en ce que matérialité et spiritualité ont cessé de s’y opposer. Parole et Verbe sont par contre dans ses écrits les indices grâce à quoi prendre la mesure de l’écart, de la déchirure séparant l’homme européen de lui-même et l’Occident de toute culture authentiquement « théâtrale » car permettant de retrouver le contact avec cette obscurité, avec ce chaos originel dont la mise en scène a pour mission de recréer l’incandescente effervescence. Démarche étrange à vrai dire que cette dramaturgie, que cette poétique « négative » usant à l’occasion pour se faire entendre d’arguments chers aux théologiens de l’apophase : « Sans nul doute, l’origine de tout ce qui existe est obscure, et l’homme prévoyant – dans les commencements de sa science – ménage un chemin, une marge, un endroit où puisse se manifester l’universelle obscurité.
Car l’étrange est que, ne sachant d’où il vient, l’homme puisse se servir de son ignorance, de cette sorte d’originelle ignorance, pour savoir exactement où il doit aller » (7).
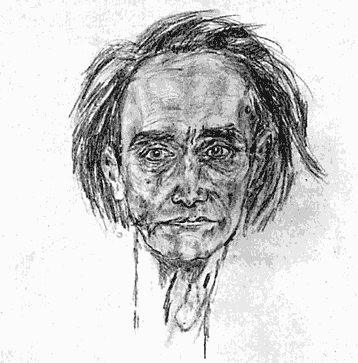 Égaré par une maladie inguérissable, Artaud certes le fut. Mais quel homme sut pourtant instinctivement mieux que lui ce qu’il devait fuir – « ce monde entièrement truqué et malade » (8) – et vers où il devait tout aussi impérativement diriger ses pas ? Or c’est à devenir pleinement acteur qu’il n’a pour ce faire cessé d’aspirer, et non pas créateur à l’image du Dieu biblique. Ce n’est pas le divin qu’Artaud rejette en tant que tel mais l’usage étriqué ou emphatique qu’en a fait l’Occident rationaliste et religieux. Le Dieu auquel l’acteur devrait s’identifier n’est pas celui qui solennellement créa le monde pour un jour de colère le réduire en cendres. C’est celui qui, tel Shiva, danse continûment sur les ruines d’une création qu’il vient d’anéantir pour mieux en renouveler les potentialités ; imposant par là même à la métamorphose d’être la seule « loi » redoutable mais respectable en ce monde : « Car le Fils-Shiva c’est aussi la Force, mais c’est la Force de Transmutation, donc de destruction des formes, c’est l’éternel passage dans et à travers les formes, sans s’arrêter jamais sur aucune, c’est donc la force même de l’Absolu » (9) écrit dans son exaltation Artaud peu après la publication de Les nouvelles révélations de l’être (1936).
Égaré par une maladie inguérissable, Artaud certes le fut. Mais quel homme sut pourtant instinctivement mieux que lui ce qu’il devait fuir – « ce monde entièrement truqué et malade » (8) – et vers où il devait tout aussi impérativement diriger ses pas ? Or c’est à devenir pleinement acteur qu’il n’a pour ce faire cessé d’aspirer, et non pas créateur à l’image du Dieu biblique. Ce n’est pas le divin qu’Artaud rejette en tant que tel mais l’usage étriqué ou emphatique qu’en a fait l’Occident rationaliste et religieux. Le Dieu auquel l’acteur devrait s’identifier n’est pas celui qui solennellement créa le monde pour un jour de colère le réduire en cendres. C’est celui qui, tel Shiva, danse continûment sur les ruines d’une création qu’il vient d’anéantir pour mieux en renouveler les potentialités ; imposant par là même à la métamorphose d’être la seule « loi » redoutable mais respectable en ce monde : « Car le Fils-Shiva c’est aussi la Force, mais c’est la Force de Transmutation, donc de destruction des formes, c’est l’éternel passage dans et à travers les formes, sans s’arrêter jamais sur aucune, c’est donc la force même de l’Absolu » (9) écrit dans son exaltation Artaud peu après la publication de Les nouvelles révélations de l’être (1936).Plus encore que Hölderlin – dont il voulait mettre en scène l’Empédocle – Artaud ne s’est détourné de la dramaturgie religieuse et théâtrale propre à l’Occident que pour mieux retrouver le sens oublié d’un destin pour une part commun à la Grèce archaïque et aux cultures « cuivrées » du Mexique, à l’Orient hindouiste et même taoïste ; que pour mieux remettre « en œuvre », au sens alchimique du terme, les forces occultes mais vives de la nature, hostile ou étrangère à ce que l’Occident nomme communément l’humain : « Je ne suis pas un homme qui se reforme. Je me forme contre l’état humain », écrira-t-il plus tard dans l’un de ses Cahiers écrits à Rodez (10). Rien de plus dérangeant chez Artaud que son mépris de l’humain qui n’aurait pas de toutes ses forces travaillé à dépasser, transfigurer son individualité limitée ; et cela jusqu’à l’anonymat que lui-même revendiqua, jusqu’à la dépersonnalisation qu’il conseillait à l’acteur de systématiquement rechercher. Aussi les mots par lesquels il désigne le théâtre « essentiel » et nécessairement cruel qu’il rêve de fonder – métaphysique, ésotérique, intérieur, absolu, alchimique – ne sont-ils eux aussi que des indices pour suggérer l’ampleur du Grand Œuvre théâtral à accomplir : « Car si l’idée primitive du théâtre n’est pas de nous permettre de tenter dans l’excavation creuse et évidée de la scène une opération psychologique analogue à celle qui est tentée dans l’alchimie, c’est-à-dire de libérer en petit des forces que l’on oblige à se contracter, le théâtre n’a pas de raison d’être » (11).
Entrer de plain-pied dans la théâtralité artaldienne revient donc à assumer « dans une âme et un corps » (Rimbaud) le double paradoxe d’un Verbe trop organique pour n’être pas étranger aux mots : une « sorte de langage extra-verbal », disait lui-même Artaud ; et d’une scène trop largement cosmique pour que celle du théâtre puisse pleinement jouer sa fonction de creuset capable de contenir et transmuer les forces vives qui s’y affronteraient : « Le théâtre ne pourra redevenir égal à lui-même que le jour où il aura retrouvé sa raison d’être, que le jour où il aura retrouvé en mode matériel, immédiatement efficace, le sens d’une certaine action rituelle et religieuse, action de dissociation psychologique, de déchirement organique, de sublimation spirituelle décisive à laquelle il était primitivement destiné » (12). Théâtre du destin aurait donc pu tout aussi bien dire Artaud de son « théâtre de la cruauté » dont les Manifestes successifs sont autant de brûlots, tandis que le seul essai qu’il en fit sur une scène en montant Les Cenci tourna au fiasco.
De cet échec cuisant, et en tous points ruineux pour lui, Artaud semble n’avoir qu’à demi tiré la leçon ; préférant s’en prendre un fois de plus à sa malchance ordinaire (« j’ai été trahi par la réalisation ») et à la malveillance de son auditoire parisien. Sans doute n’était-ce là, concéda-t-il cependant, qu’une préparation encore maladroite du théâtre authentiquement « cruel » dont ses Lettres et Manifestes avaient brossé les traits saillants. À aucun moment ne lui vint à l’esprit qu’il ait pu exalter dans ce qu’il nommait de façon ambiguë « sa » tragédie la forme de cruauté, sanglante et sadique, à laquelle il souhaitait justement ne pas voir réduite la théâtralité. Affirmant vouloir attaquer dans cette pièce « la superstition sociale de la famille », Artaud prenait effectivement ainsi une « position idéologique » à l’endroit de l’Ordre, de la Justice, de la Religion et de la Patrie ; mais une position incompatible avec la théâtralité qu’il préconisait et croyait pouvoir simultanément décrire ainsi : « J’ai imposé à ma tragédie le mouvement de la nature, cette espèce de gravitation qui meut les plantes, et les êtres comme des plantes, et qu’on retrouve fixée dans les bouleversements volcaniques du sol » (13). N’est-ce donc là que rhétorique au regard du drame familial orchestré par Artaud ?
La reprise récente des Cenci, mis en scène par Georges Lavaudant à l’Odéon, montre à l’évidence les limites du scénario réécrit par Artaud à partir du drame de Shelley, et incite même à se demander si l’on peut qualifier de tragédie cette atroce mécanique à broyer pour rien les vies ; pour rien sinon pour que se satisfasse en vase clos le désir incestueux du vieux Cenci dont la monstruosité n’est pourtant à cet égard que transgression sacrilège, défi lancé au Pape autant qu’à un Dieu créateur incapable de protéger l’innocence de telles saillies. Mais à défaut d’une innocence dont la culpabilité suscitait la compassion des Grecs anciens, des personnages amoraux, « ni innocents ni coupables » précise Artaud, endossent à leur insu le sort d’un monde « incertain entre le mal et le bien » (14). Qu’y a-t-il donc de tragique dans les provocations du Comte Cenci, plus proche de la cruauté perverse et somme toute frivole des héros de Sade et de Genêt que de la théâtralité « cruelle » que voulait ressusciter Artaud ? En dépit de la fatalité évoquée par l’infortunée Béatrice, jamais n’entrent vraiment en jeu ni en scène les fameuses « forces », naturelles et cosmiques, supposées restituer à la dramaturgie sa dimension alchimique et thérapeutique. Affirmant s’identifier au destin et se prenant pour une force indomptable de la nature, Cenci n’obéit qu’à sa propre loi et, semant le mal autour de lui, reste prisonnier de sa sauvagerie. C’est en Enfer qu’ici l’on descend, sans rémission possible des péchés commis ni espérance d’une autre vie : « Je rejette vers le dieu qui m’a faite cette âme comme un incendie qui le guérisse de créer » (15), dit Béatrice peu avant sa mort précoce.
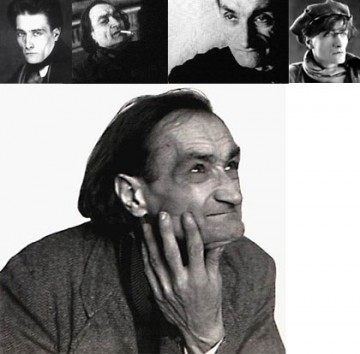
Du moins orchestrent-ils une sorte de tragédie du Verbe qui pourrait bien rester commune à notre époque et à Artaud. Tragédie par étranglement pourrait-on dire, par strangulation quand se fait trop irrespirable le tiraillement entre un désir d’incarnation, d’ordre centripète, et la « force de gravitation » exerçant sur chaque individu son action centrifuge ; une force qu’Artaud pensait naturelle et cosmique, destinale pour tout dire, mais que l’époque moderne a monnayée en pure et simple extraversion, en stérile dispersion chaque fois que la prolifération des mots et des images démagnétise le Verbe. Raréfiées à l’extrême dans la scénographie de Lavaudant, les séquences verbales paraissent davantage l’expression d’une telle suffocation, devenue stridente ou à peine audible, que le point d’orgue restituant aux mots une force incantatoire qui serait celle de la vie. Fuyant après l’échec des Cenci le « mauvais destin » qui en Europe le harcelait, Artaud crut au Mexique voir, sentir se desserrer pour lui l’étau. Sa respiration s’y fit plus ample, et son espoir de guérison donna alors à son Verbe un éclat plus vif et plus tendre. Les pages écrites là-bas témoignent en tout cas d’une exaltation flamboyante, pondérée par l’attraction centripète d’une terre où l’épanouissement de la vie universelle semble avoir force de loi. Miraculeux mais fragile équilibre ! Loin de l’Enfer « familial » de l’Europe, Artaud dit trouver confirmation de ce que la théâtralité qu’il ambitionnait de restituer à un Occident raisonneur et décadent ait spontanément revêtu au Mexique une dimension tellurique et cosmique capable de se révéler puissamment thérapeutique.
Mais ce n’était là qu’une échappée, et l’amplitude même de l’écart travaillait en sous-main à resserrer le nœud tragique qui devait peu après le reprendre dans ses rets. Cinq années seulement séparent le séjour chez les Tarahumaras de l’internement à Rodez où une seule question obsèdera désormais Artaud : comment sortir d’un monde créé par un Dieu-Père géniteur mais irresponsable à l’endroit de sa propre Création ? Un monde à l’image de l’Enfer où il n’est d’autre réponse au désir d’incarnation que l’inceste, et d’autre réplique aux crimes des Dieux et des Pères que leur meurtre sanglant. Ils sont alors loin, les « Dieux tournants » du Mexique qui, « montrant comment l’homme pourrait sortir de lui (…) lui donnent en même temps le moyen de rentrer dans quelque chose » (17) ! C’est au fond à dépasser, déconstruire, exorciser le scénario des Cenci que travaille dès lors comme un forcené Artaud qui jamais ne renonça à un théâtre tout aussi cruel qu’alchimique ; un théâtre dont la scène demeure plus que jamais foyer, creuset où une mystérieuse opération permet au souffle de prendre directement « corps » en ce qu’elle ne reproduit plus en rien le geste créateur divin. Purifiant la théâtralité de toute « représentation », le geste d’Artaud donne aussi tout son sens à l’un de ses propos anciens : « Le théâtre en soi ne m’intéresse pas, le théâtre détaché du reste » (18). Accusé d’avoir accompagné la création d’un monde inique et irrespirable, le Verbe semble alors en lui-même résorber ce qui n’était pas souffle, un peu comme à la fin du Ring de Wagner l’Anneau porteur de tous les maléfices retourne au Rhin.
(1) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t. XIV*, Suppôts et suppliciations, Paris, Gallimard, 1978, p. 85.
(2) Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Œuvres complètes, t. IV, Paris, Gallimard, 1964, p. 72.
(3) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.V, Paris, Gallimard, 1964, p.101.
(4) Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, op. cit., p.160. Cf. aussi Françoise Bonardel, « Poésie et Tradition – Artaud lecteur de Guénon », Modernités d’Antonin Artaud, Paris,
Lettres modernes Minard, 2000, p. 119 à 148.
(5) Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, op. cit., p. 61.
(6) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.V, op. cit., p. 303.
(7) Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, Œuvres complètes, t.VIII, Paris, Gallimard, 1971, p. 225.
(8) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t. XIV*, Suppôts et supplications, op. cit., p.10.
(9) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.VII, Paris, Gallimard, 1974, p. 287.
(10) Antonin Artaud, Cahiers de Rodez, Œuvres complètes, t. XVIII, Paris, Gallimard, 1983, p. 69.
(11) Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, op. cit., p. 295. Cf. sur ce point Françoise Bonardel, Antonin Artaud ou la fidélité à l’infini, Paris, Balland, 1987.
(12) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t. V, op. cit., p.115.
(13) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.V, op. cit., p. 45.
(14) Antonin Artaud, Les Cenci, Œuvres complètes, t.V, op.cit., p 269.
(15) Antonin Artaud, Les Cenci, Œuvres complètes, t. IV, op. cit., p. 365.
(16) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.V, op. cit., p.15.
(17) Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, op. cit., p.167.
(18) Antonin Artaud, Œuvres complètes, t.V, op. cit., p. 316.
(Ce texte a été publié dans le N°19 de la revue Contrelittérature, Printemps-Été 2007, pp. 6-9 )

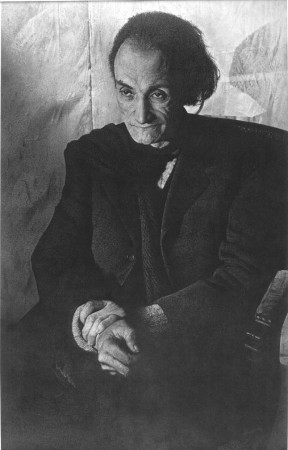

 Imprimer
Imprimer